Imaginez ce brave Monsieur de La Palice, qui dès le matin entamait une série de phrases dans son style si particulier :
- « J’ai passé une bonne nuit parce que j’ai bien dormi. »
- « Si je dis que mon café est bon, c’est parce qu’il a bon goût. »
- « Demain, le temps sera pluvieux, et je serai plus vieux moi aussi. »
On compâtit, en imaginant le calvaire de ses domestiques et de ses proches, forcés de l’écouter annoner des évidences à longueur de journée tout en se demandant s’il n’était pas un peu djoum djoum.
Et pourtant, Monsieur de La Palice (1470–1525) n’a jamais proféré de lapalissade de sa vie. Il fut en réalité un vaillant combattant, dirigeant plusieurs armées au cours des guerres d’Italie, notamment pour compte de François Ier. C’est une erreur de recopiage d’un mot dans un texte en son honneur qui a transformé une jolie phrase en une tautologie niaise. Depuis lors, pour la plupart de nos concitoyens, Monsieur de La Palice personnalise les affirmations pléonasmiques et l’ensemble des phrases qui fournissent une explication sans rien nous apprendre de neuf.
Il s’agit dès lors de rétablir la vérité et de lui rendre cet hommage posthume (et c’est parce qu’il est mort qu’on peut lui rendre un hommage posthume).
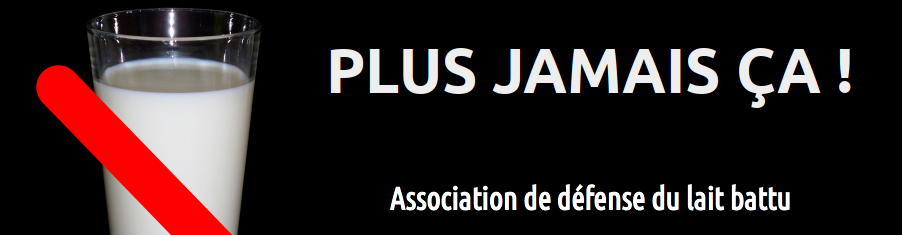
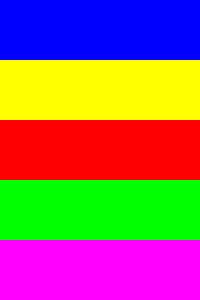 (après)
(après) 